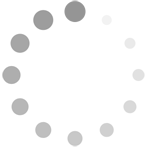Refine search
Actions for selected content:
62 results
Nouveau regard sur les déterminants de l’appui à l’indépendance du Québec
-
- Journal:
- Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique , First View
- Published online by Cambridge University Press:
- 12 September 2025, pp. 1-22
-
- Article
-
- You have access
- Open access
- HTML
- Export citation
Qui devrait légalement être considéré comme lobbyiste au Québec ?
-
- Journal:
- Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique / Accepted manuscript
- Published online by Cambridge University Press:
- 09 September 2025, pp. 1-13
-
- Article
- Export citation
La culture stratégique québécoise à l’aune de la guerre en Ukraine
-
- Journal:
- Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique / Volume 58 / Issue 3 / September 2025
- Published online by Cambridge University Press:
- 06 August 2025, pp. 591-615
-
- Article
-
- You have access
- HTML
- Export citation
Federalized Two-step Migration in Quebec: An Ambiguous Process of Inclusion
-
- Journal:
- Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique / Volume 58 / Issue 1 / March 2025
- Published online by Cambridge University Press:
- 21 May 2025, pp. 171-195
-
- Article
- Export citation
Les fonctionnaires parlementaires : un rôle administratif ou politique? Le cas de l'Assemblée nationale du Québec
-
- Journal:
- Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique / Volume 58 / Issue 2 / June 2025
- Published online by Cambridge University Press:
- 13 May 2025, pp. 297-318
-
- Article
-
- You have access
- Open access
- HTML
- Export citation
A Party that Went Viral? The Drivers of Support for the Parti Conservateur du Québec in the 2022 Election
-
- Journal:
- Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique / Volume 58 / Issue 2 / June 2025
- Published online by Cambridge University Press:
- 28 April 2025, pp. 277-296
-
- Article
-
- You have access
- Open access
- HTML
- Export citation
L'inconfort ou l'indifférence ? Comprendre l'opposition aux mesures visant à contrer la mésinformation au Québec
-
- Journal:
- Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique / Volume 57 / Issue 4 / December 2024
- Published online by Cambridge University Press:
- 23 December 2024, pp. 877-898
-
- Article
-
- You have access
- Open access
- HTML
- Export citation
Does Soft Power Look Different in Multinational Federations? International Education and Soft Power Politics in Canada/Quebec
-
- Journal:
- Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique / Volume 57 / Issue 3 / September 2024
- Published online by Cambridge University Press:
- 31 October 2024, pp. 602-625
-
- Article
- Export citation
Gilles Deleuze au Québec
-
- Journal:
- Dialogue: Canadian Philosophical Review / Revue canadienne de philosophie / Volume 63 / Issue 2 / August 2024
- Published online by Cambridge University Press:
- 11 October 2024, pp. 375-396
-
- Article
-
- You have access
- Open access
- HTML
- Export citation
Qui paie gagne. Égalité démocratique, inégalités économiques et financement électoral au Canada
-
- Journal:
- Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique / Volume 57 / Issue 2 / June 2024
- Published online by Cambridge University Press:
- 22 September 2024, pp. 254-277
-
- Article
-
- You have access
- Open access
- HTML
- Export citation
Les courants nationalistes à l’épreuve des générations : analyses des attitudes et choix de vote des Québécois.es de 2007 à 2022
-
- Journal:
- Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique / Volume 57 / Issue 2 / June 2024
- Published online by Cambridge University Press:
- 03 May 2024, pp. 364-386
-
- Article
-
- You have access
- Open access
- HTML
- Export citation
A Comprehensive Dataset of Four Provincial Legislative Assembly Members
-
- Journal:
- Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique / Volume 57 / Issue 2 / June 2024
- Published online by Cambridge University Press:
- 03 May 2024, pp. 301-307
-
- Article
-
- You have access
- Open access
- HTML
- Export citation
Par-delà l'obligation d'exploiter le territoire : Autodétermination des communautés locales et transition énergétique au Québec
-
- Journal:
- Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique / Volume 57 / Issue 3 / September 2024
- Published online by Cambridge University Press:
- 18 April 2024, pp. 532-552
-
- Article
-
- You have access
- Open access
- HTML
- Export citation
Discours public québécois sur l'affaire du mot en « n » : entre dénonciation d'une insulte raciale et défense des libertés universitaires
-
- Journal:
- Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique / Volume 56 / Issue 4 / December 2023
- Published online by Cambridge University Press:
- 02 January 2024, pp. 950-974
-
- Article
-
- You have access
- Open access
- HTML
- Export citation
Pathways to depalatalization of the palatal nasal in Quebec and hexagonal French: An EPG study
-
- Journal:
- Journal of French Language Studies / Volume 34 / Issue 2 / July 2024
- Published online by Cambridge University Press:
- 26 October 2023, pp. 95-124
-
- Article
-
- You have access
- Open access
- HTML
- Export citation
Le Scotland Act Reference, les référendums sur l’indépendance et le droit à l’autodétermination des peuples
-
- Journal:
- Canadian Yearbook of International Law / Annuaire canadien de droit international / Volume 60 / November 2023
- Published online by Cambridge University Press:
- 19 October 2023, pp. 206-218
- Print publication:
- November 2023
-
- Article
-
- You have access
- Open access
- HTML
- Export citation
Analyse des bulletins de vote rejetés et de l'effet du rallye pour l'unité canadienne lors du référendum québécois de 1995
-
- Journal:
- Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique / Volume 57 / Issue 1 / March 2024
- Published online by Cambridge University Press:
- 17 October 2023, pp. 215-227
-
- Article
-
- You have access
- Open access
- HTML
- Export citation
L'aptitude au travail comme heuristique de mérite dans la formation des opinions à l’égard des personnes assistées sociales
-
- Journal:
- Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique / Volume 56 / Issue 2 / June 2023
- Published online by Cambridge University Press:
- 04 July 2023, pp. 325-348
-
- Article
- Export citation
Chapter 5 - Performative Accents
- from Part I - Translation as Medium and Method
-
-
- Book:
- Performance and Translation in a Global Age
- Published online:
- 10 August 2023
- Print publication:
- 29 June 2023, pp 104-134
-
- Chapter
- Export citation
The Right and the (Provincial) Welfare State: The Case of the Coalition Avenir Québec Government
-
- Journal:
- Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique / Volume 56 / Issue 3 / September 2023
- Published online by Cambridge University Press:
- 21 June 2023, pp. 636-655
-
- Article
-
- You have access
- Open access
- HTML
- Export citation