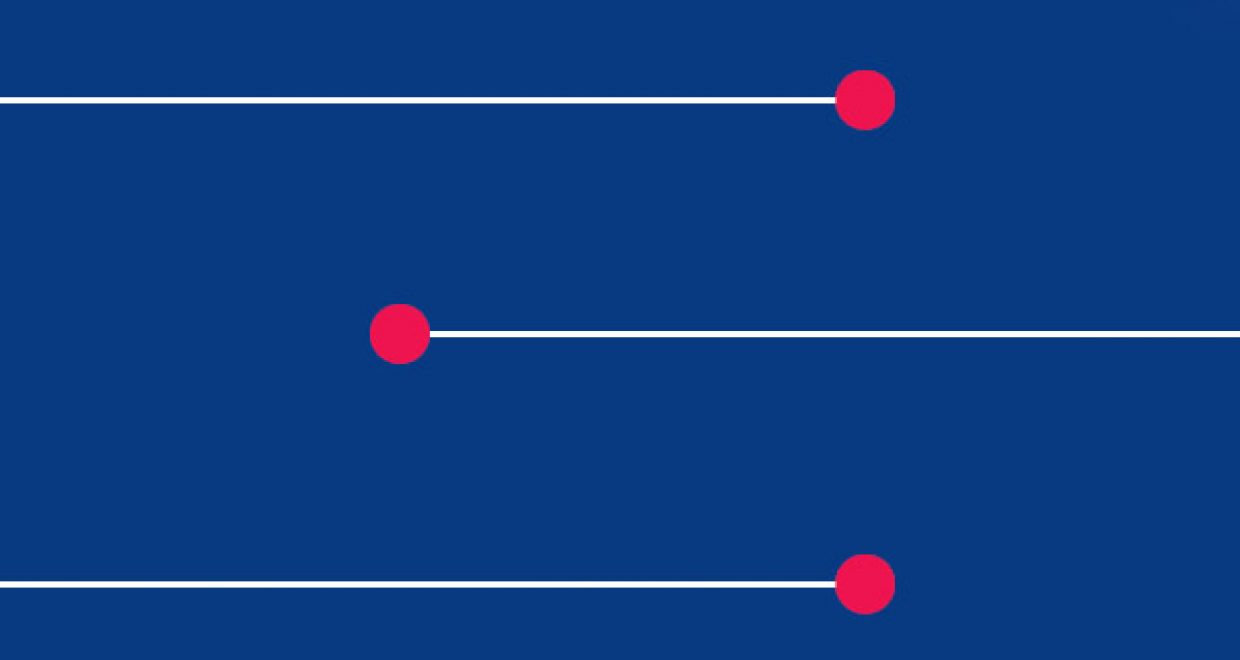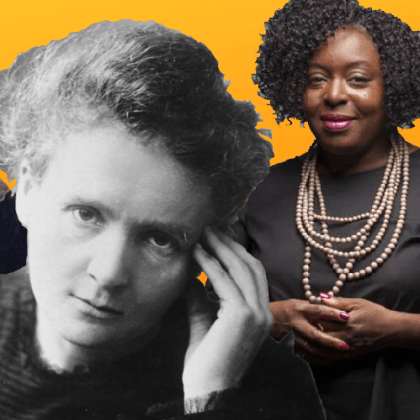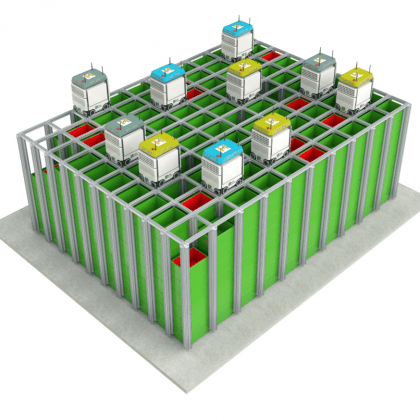2020 John McMenemy Prize Nominees Luc Turgeon, Antoine Bilodeau, Stephen E. White and Ailsa Henderson
Interview with 2020 John McMenemy Prize Nominees Luc Turgeon, Antoine Bilodeau, Stephen E. White and Ailsa Henderson; “A Tale of Two Liberalisms? Attitudes toward Minority Religious Symbols in Quebec and Canada”.
Please give us a nutshell summary of your nominated article, “A Tale of Two Liberalisms? Attitudes toward Minority Religious Symbols in Quebec and Canada”.
Our article explores why Quebecers are more likely than other Canadians to support restrictions on the wearing of minority religious symbols. It first examines whether explanations commonly associated with support for such restrictions can explain the gap: stronger prejudice, greater feelings of cultural insecurity and lower levels of religiosity. Our study indicates that while those factors do influence public opinion in both Quebec and the rest of Canada, they do not explain differences between Quebec and the rest of Canada.
Our analyses suggest that it is the distinctive impact of liberal values that explain why more Quebecers than other Canadians support restrictions to minority religious symbols. In Quebec, holding liberal values is associated with greater support for restrictions while in the rest of Canada holding liberal values is associated with lower support. These findings are consistent with the argument that different interpretations of liberalism dominate in both societies: Enlightenment liberalism in Quebec and Reformation liberalism in the rest of Canada. The main difference between those two forms of liberalism comes down ultimately to the extent to which the state should promote or enforce liberal values.
What led to your interest in conducting research on liberalism and religious symbols in Quebec and Canada?
In some ways, the four of us have been talking about differences between Quebec and the rest of Canada ever since we met at the University of Toronto about twenty years ago. This article is very much a continuation of those discussions over the years.
More concretely, when paying attention to current debates, our perception was that proponents of restrictions on the wearing of religious symbols in Quebec often framed their discourse in the language of liberalism, with references to “state neutrality”, “gender equality”, and “freedom of conscience”. We were curious to see whether such elite discourse had any influence on public opinion, and whether it might explain why Quebecers were more likely than other Canadians to support such restrictions.
The work of Jocelyn Maclure and Phil Triadafilopoulos also greatly influenced how we thought and designed this article. In the early 2010s, Jocelyn Maclure had argued that intellectual debates on religious accommodations in Quebec revealed the presence of “strange bedfellows”, and that one of those groups of intellectuals explicitly opposed religious accommodation on liberal grounds. Around the same time, Phil Triadafilopoulos published an article discussing how proponents of controversial civic integration policies in Europe justified their position on liberal ground, and how debates about those policies demonstrated the existence of a tension between different strands of liberalism. These arguments and observations really triggered a spark among members of the team, and we really wanted to see how that sort of reasoning might translate empirically at the level of public opinion.
Do you have any advice for graduate students or other scholars who might be interested in pursuing research on religion and liberalism in Canadian politics?
One of the great pleasures we had in conducting this research project has been to put in common the various fields of expertise and methodological skills that each one of us had to offer. We believe the contribution to the discipline from this article is in large part the result of the great synergy that emerged out of this fruitful mix of expertise. Our advice, then, would not be specifically limited to graduate students interested in pursuing research on religion and liberalism in Canadian politics; our advice would be to dare to connect with colleagues of different backgrounds and expertise to tackle complex political realities. Our project connected “religion”, “political theory” along with “numbers” to better make sense of current political debates in Canada; we believe this is what made it fun to do!
Tell us a bit about your current/next project. What are each of you working on?
The four of us are finishing various articles related to our “Provincial Diversity Project” that seeks to better understand dynamics of attitudes toward ethnocultural diversity and ethnic minorities’ integration across the Canadian provinces.
Antoine and Luc also have a new project with Laurence Lessard-Philipps (Birmingham) that explores how Quebecers conceive of Quebec identity, how such conceptions vary among localities across the province, and how such conceptions relate to attitudes toward ethnocultural diversity, immigration and social solidarity. Steve’s new project explores beliefs about immigration, multiculturalism, and Canadian identity among Canadians outside Quebec. Ailsa continues to lead the Scottish Election Study and co-direct the Future of England Survey, which started as a survey of English attitudes in 2011 but now conducts comparative surveys on identity and constitutional attitudes across the four territories of the UK. Both of these projects analyse sub-state political behaviour within and across the state.
—
Entrevues avec les finalistes au prix John McMenemy 2020 Luc Turgeon, Antoine Bilodeau, Stephen E. White and Ailsa Henderson; “A Tale of Two Liberalisms? Attitudes toward Minority Religious Symbols in Quebec and Canada”.
Pouvez-vous nous faire un bref résumé de votre article sélectionné “A Tale of Two Liberalisms? Attitudes toward Minority Religious Symbols in Quebec and Canada”.
Notre article explore les raisons pour lesquelles les Québécois sont plus enclins que les autres Canadiens à soutenir les restrictions sur le port de signes religieux. Il examine d’abord si les explications couramment associées au soutien de telles restrictions peuvent expliquer cet écart : des préjugés plus forts, un sentiment d’insécurité culturelle plus grand et des niveaux de religiosité plus faibles. Notre étude indique que si ces facteurs influencent effectivement l’opinion publique tant au Québec que dans le reste du Canada, ils n’expliquent pas les différences entre le Québec et le reste du Canada.
Nos analyses suggèrent que c’est l’impact distinctif des valeurs libérales qui explique pourquoi les Québécois sont plus nombreux que les autres Canadiens à soutenir les restrictions préconisées au sujet du port de signes religieux. Au Québec, la conformité aux valeurs libérales est associée à une prise de position plus restrictive, alors que dans le reste du Canada, les valeurs libérales se traduisent par un soutien plus faible. Ces résultats sont conformes à l’argument selon lequel deux interprétations différentes du libéralisme dominent dans les deux sociétés, à savoir le libéralisme des Lumières au Québec et le libéralisme de la Réforme dans le reste du Canada. La principale différence entre ces deux formes de libéralisme se résume en fin de compte à la mesure dans laquelle l’État est tenu de promouvoir ou appliquer les valeurs libérales.
Qu’est-ce qui vous a amenés à vous intéresser à la recherche sur le libéralisme et les signes religieux au Québec et au Canada?
D’une certaine manière, nous parlons tous les quatre des différences entre le Québec et le reste du Canada depuis notre rencontre à l’Université de Toronto il y a une vingtaine d’années. Le présent article s’inscrit dans le prolongement de ces discussions au fil des ans.
Plus concrètement, en prêtant attention aux débats actuels, notre perception était que les partisans des restrictions sur le port de signes religieux au Québec enrobaient souvent leur discours dans le langage du libéralisme, par référence à la « neutralité de l’État », à « l’égalité des sexes » et à la « liberté de conscience ». Nous étions curieux de voir si ce discours élitaire avait une quelconque influence sur l’opinion publique, et s’il pouvait expliquer pourquoi les Québécois étaient plus enclins que les autres Canadiens à soutenir de telles restrictions.
Le travail de Jocelyn Maclure et de Phil Triadafilopoulos a également beaucoup influencé la façon dont nous avons pensé et conçu cet article. Au début des années 2010, Jocelyn Maclure avait soutenu que les débats intellectuels sur les accommodements religieux au Québec révélaient la présence d’« étranges compagnons de lit », et qu’un de ces groupes d’intellectuels s’opposait explicitement aux accommodements religieux en se fondant sur des principes libéraux. À peu près à la même époque, Phil Triadafilopoulos publiait un article sur la façon dont les partisans de politiques d’intégration civique controversées en Europe justifiaient leur position sur des bases libérales et dont les débats sur ces politiques démontraient l’existence d’une tension entre les différents courants du libéralisme. Ces arguments et observations ont réellement déclenché une étincelle parmi les membres de l’équipe, et nous voulions vraiment voir comment ce genre de raisonnement pouvait se traduire empiriquement au niveau de l’opinion publique.
Auriez-vous des conseils à donner aux étudiants des cycles supérieurs ou à d’autres universitaires désireux de poursuivre des recherches sur la religion et le libéralisme dans la politique canadienne?
Un des grands plaisirs que nous avons eu à mener à bien ce projet a été de mettre en commun les différents domaines d’expertise et les compétences méthodologiques que chacun d’entre nous avait à offrir. Nous pensons que la contribution de cet article à la discipline est en grande partie le résultat de la synergie qui a émergé de cette fructueuse combinaison d’expertise. Notre conseil ne se limiterait donc pas spécifiquement aux étudiants de troisième cycle intéressés à poursuivre des recherches sur la religion et le libéralisme dans la politique canadienne ; ils devraient oser entrer en contact avec des collègues d’origines et de compétences différentes pour aborder des réalités politiques complexes. Notre projet a mis en regard la « religion » la « théorie politique » et les « données chiffrées » afin de mieux comprendre les débats politiques actuels au Canada ; nous pensons que c’est ce qui a rendu ce projet plaisant !
Parlez-nous brièvement du projet auquel vous travaillez en ce moment ou que vous comptez aborder.
Nous terminons tous les quatre divers articles liés à notre « Projet de diversité provinciale » qui cherche à mieux comprendre la dynamique des attitudes à l’égard de la diversité ethnoculturelle et de l’intégration des minorités ethniques dans les provinces canadiennes.
Antoine et Luc poursuivent également un nouveau projet avec Laurence Lessard-Philipps (Birmingham) qui explore comment les Québécois conçoivent l’identité québécoise, la diversité de ces conceptions selon les localités de la province et leur lien avec les attitudes concernant la diversité ethnoculturelle, l’immigration et la solidarité sociale. Le nouveau projet de Steve explore les croyances sur l’immigration, le multiculturalisme et l’identité canadienne chez les Canadiens hors Québec. Ailsa continue de diriger l’Étude sur l’élection écossaise et codirige l’enquête sur l’avenir de l’Angleterre, qui a commencé comme une enquête sur les attitudes des Anglais en 2011, mais qui s’étend désormais aux enquêtes comparatives sur les attitudes identitaires et constitutionnelles dans les quatre territoires du Royaume-Uni. Ces projets analysent, tous deux, le comportement politique infra-étatique, au sein et à travers l’État.